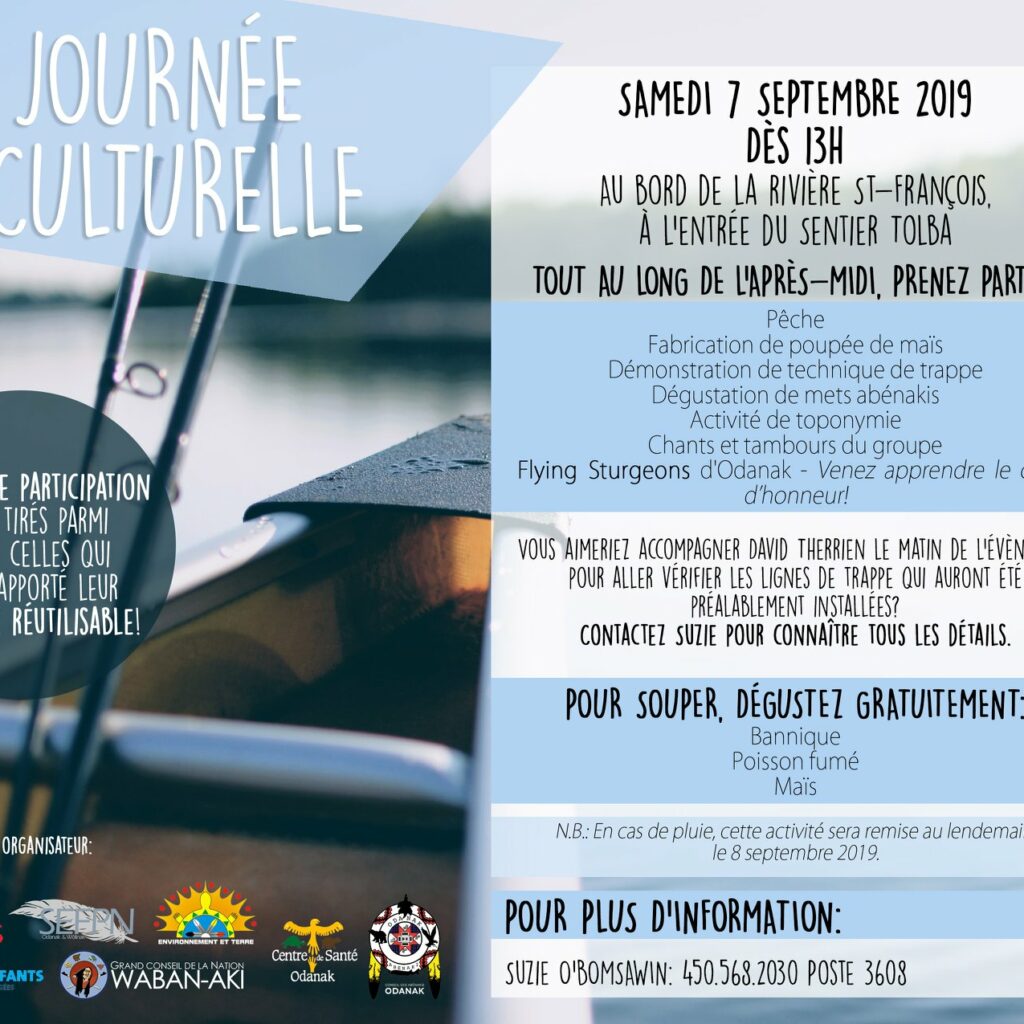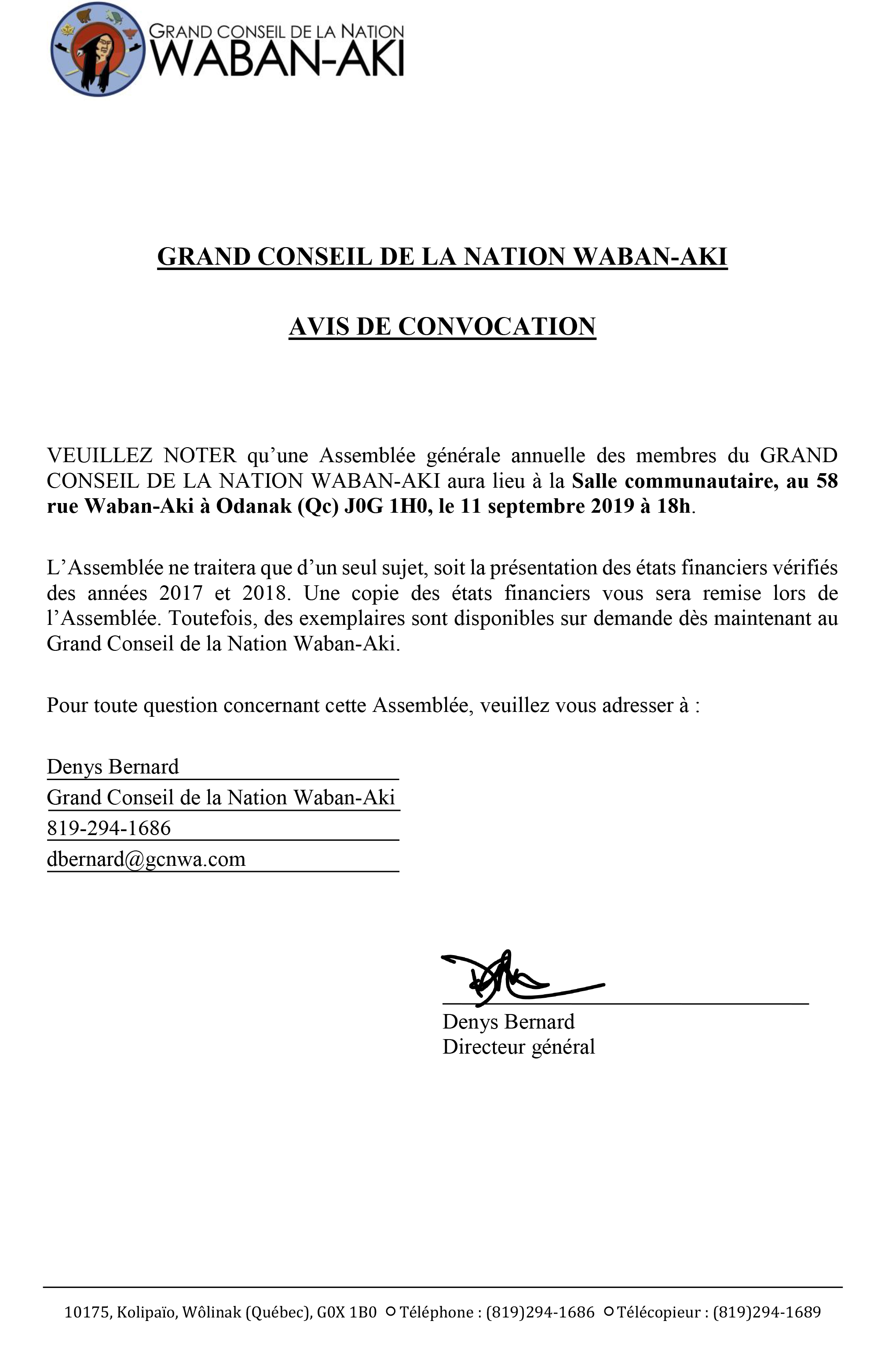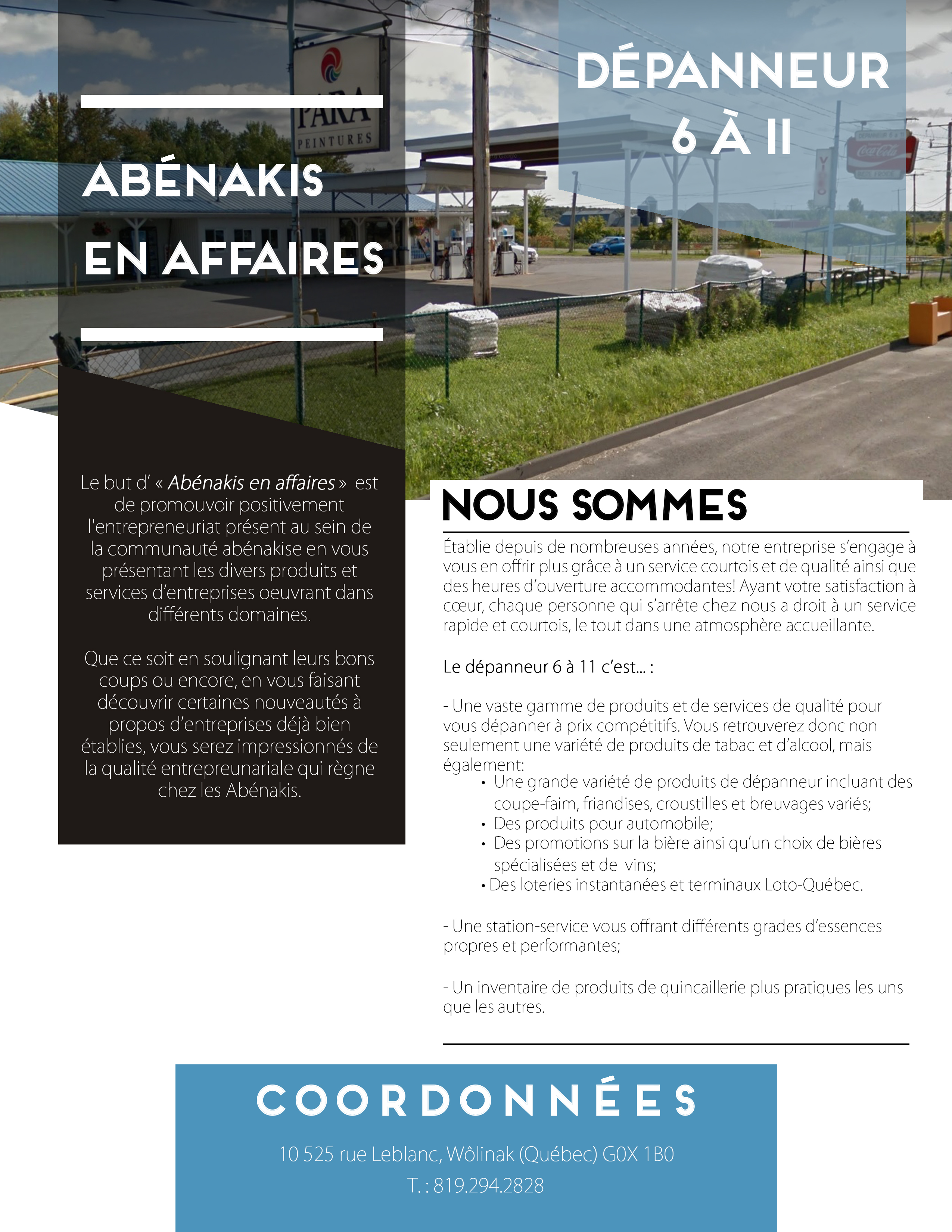Une construction inusitée à Odanak
L’archéologue Geneviève Treyvaud en compagnie de Vicky Desfossés-Bégin du Musée des Abénakis d’Odanak. Derrière, on aperçoit la structure de la maison traditionnelle et quelques travailleurs. (Photo) (Photo : Marie-Eve Veillette)
Une maison traditionnelle abénakise du 19e siècle est sur le point d’ouvrir ses portes sur le terrain du Musée des Abénakis d’Odanak.
La semaine dernière, la structure prenait forme. Elle est composée de pieux taillés dans des billots d’épinette provenant des forêts publiques du territoire ancestral abénakis (le Ndakinna). Dans les jours suivants, on prévoyait procéder au recouvrement des murs, qui sera quant à lui en écorce synthétique, composée de plastique recyclé.
«C’est une maison traditionnelle, oui, mais construite selon les contraintes et les réalités du 21e siècle, précise l’archéologue Geneviève Treyvaud, membre de l’équipe de travail. Autrefois, les Abénakis changeaient l’écorce de leur résidence à chaque année, ce qui est impensable aujourd’hui en raison de la réglementation entourant la protection des forêts.»
«C’est une adaptation contemporaine de l’habitation que l’on fait, ajoute Vicky Desfossés-Bégin, du Musée des Abénakis. On la reproduit avec la matière d’aujourd’hui pour une question de durabilité aussi.»
Un projet riche d’histoire
La réalisation de ce bâtiment a lieu sur le site même où des fouilles archéologiques, menées de 2010 à l’année dernière, ont permis de mettre au jour des traces de ce genre d’habitation. Ces recherches, rappelons-le, portaient sur la mission fortifiée du fort abénakis, datant entre 1680 et 1759.
«Quand on a mené les fouilles, on a trouvé plusieurs traces de poteaux, de piquets et de pieux», indique Mme Treyvaud, précisant que ces traces ont été laissées lorsqu’ils ont brûlé, après que les troupes du major Robert Rogers aient attaqué le fort abénakis et incendié le village et la chapelle en 1759.
L’idée de départ était de reproduire une habitation de cette époque. Or, le projet a été revu en fonction du bois disponible pour le réaliser. «On s’attendait à recevoir des perches de bois… mais on nous a livré des arbres!, rigole Mme Treyvaud. Les Premières nations étaient très fortes pour s’adapter à leur environnement et aux ressources disponibles, alors on poursuit dans la même veine!»
En bout de ligne, c’est un mal pour un bien, estime Vicky Desfossés-Bégin, puisque la maison traditionnelle du début du 19e siècle n’est pas un type d’habitation présenté ailleurs au Québec. En effet, ce sont plutôt des habitations préhistoriques précoloniales qu’on peut habituellement visiter; un peu comme celle qui était prévue au début du projet. «On s’est dit qu’avec [le matériel reçu], on allait pouvoir miser sur une période moins connue de l’histoire des Premières nations», mentionne Mme Treyvaud.
C’est donc une maison représentant la période de contact avec les Européens et le début de la colonie que le Musée proposera à ses visiteurs. «C’est un moment où la maison autochtone est très métissée en raison des deux cultures qui se côtoient. Chacune prend un peu de l’autre. D’un côté, les premiers colons s’adaptent à la nourriture des autochtones et à leurs façons de pêcher et de chasser; de l’autre, les Premières nations adaptent leur outillage avec des matériaux européens, comme la céramique et les chaudrons en cuivre.»
Bienvenue dans Kwigw8mna!
L’habitation sera entièrement aménagée avec des reproductions d’artefacts. On aura l’impression d’entrer chez quelqu’un.
Pour en arriver à recréer ce milieu de vie d’autrefois, l’équipe derrière le projet a effectué une grande recherche sur les maisons traditionnelles construites par les Abénakis sur l’ensemble du Ndakinna, qui englobe non seulement une bonne partie du sud du Québec jusqu’à la rivière Chaudière, mais aussi le Maine et le New Hampshire. «On a consulté toutes sortes de sources historiques afin d’avoir un portrait réaliste tant de l’intérieur que de l’extérieur de ces habitations», explique Mme Treyvaud.
Les données archéologiques recueillies durant les huit années de fouilles à Odanak ont également été des alliées précieuses pour la réalisation du projet.
Malgré tout, l’équipe de travail n’a pas la prétention d’affirmer que sa construction sera une maison authentique. «Elle n’aura pas nécessairement la même forme. On pense que les maisons étaient peut-être plus rondes. Par contre, il y en avait possiblement d’autres formes également.»
La construction a commencé le 25 juin. On prévoit la terminer cette semaine, si tout va bien. C’est l’entreprise montréalaise Technologies autochtones qui réalise les travaux, aidée de trois résidents d’Odanak.
Une fois la structure et le revêtement terminés, on procédera à l’aménagement intérieur, puis extérieur. «Tout autour de l’habitation, on veut aménager un potager de plantes médicinales et traditionnelles, avec des graines indigènes de l’époque», indique Vicky Desfossés-Bégin.
Notons en terminant que le projet a été financé par Patrimoine Canadien. Il a aussi obtenu un soutien du conseil de bande, du grand conseil et du bureau du Ndakinna. Le nouvel attrait portera le nom de Kwigw8mna, qui signifie «notre maison» en abénakis.
Source: Article de Marie-Ève Veillette dans Le Courrier Sud